open data
Domaines
Harvested
Provided by
Type of resources
Available actions
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
-
-

Périmètres des PPRN en Haute-Garonne couche produite et mise à jour par la ddt31 : http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/metadata/fr-120066022-jdd-5e97c19d-988a-42ae-80ca-1b5540600e43
-
Fiche PACOM Géothermie Occitanie
-
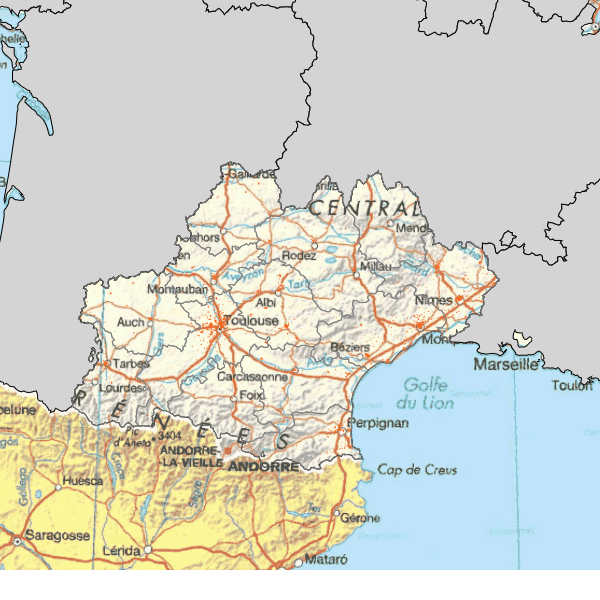
La constitution d’une tache urbaine donne une image de l’emprise urbaine à un moment donné. Les fichiers fonciers permettent de reconstituer une tache urbaine à partir des parcelles bâties selon la date de construction des locaux. On peut ainsi retracer par périodes la progression de l’urbanisation au sein d’un territoire. En particulier on peut mesurer : - la surface des taches urbaines par commune à différentes dates retenues. - le taux d’évolution de ces surfaces par commune. a – Surfaces considérées : La cartographie de l’étalement urbain est réalisée à partir de la table des propriétés non bâties des fichiers fonciers 2016 qui contient les superficies artificialisées de la parcelle. (les fichiers fonciers 2016 renseignent les constructions jusqu’en 2015). b – Champ d’observation : La méthode retient l’ensemble des parcelles bâties. c – Période d’observation : La date de référence pour l’urbanisation est calculée à partir de l’année de construction du local le plus ancien. Les parcelles possédant un local et ne précisant pas la date de construction sont conservées et font donc partie des parcelles bâties à la tache urbaine de référence. Pour toute la région Occitanie, le calcul de la surface urbanisée a été conduit en 2005 et 2015, d – Méthode d’élaboration de la tache urbaine : A partir des localisants des parcelles bâties, des disques correspondants à la surface artificialisée ont été construits à l’aide d’un outil SIG (Qgis, MapInfo). Un rayon maximal de 70 mètres est appliqué pour ne pas retenir les très grandes parcelles pouvant majorer le résultat. Pour les parcelles manifestement sous-estimées, un rayon minimal R = 20 mètres est appliqué. L’artificialisation minimale d’une parcelle est de 1 256 m². Il est procédé à une dilatation de 30 mètres. Après union, il est procédé à une érosion de 30 mètres. Cette dilatation/érosion permet de définir les zones d’influence urbaine en prenant notamment en compte les voiries à l’intérieur des taches. e – Résultats de la méthode : Les taches urbaines obtenues sont découpées suivant les limites communales pour en obtenir un tableau de synthèse à la maille communale permettant des agrégations à toutes les échelles de la planification.
-

POLMAR_Scan25-Littoral
-
Unités de distribution d'eau UDI gérées par l'Agence Régionale de Santé Occitanie
-
Service WFS - Séries de photos aériennes obliques réalisées depuis 1970 par les services de l'état en charge du littoral. Une couche comprend une mission. Le lien sur les photos se fait par la colonne n_photo.
-
Service WFS - Il s'agit du type de document d'urbanisme en vigueur à l'échelle communale, carte communale, PLU, PLUi, POS. Le règlement national d'urbanisme (RNU) s'applique pour les communes non dotées de document d'urbanisme en vigueur. Ces données sont extraites de l'application nationale SUDOCUH et consolidée par la direction aménagement de la DREAL en lien avec le réseau planification en DDT/M.
-
Service WFS - Localisation des plates-formes de maturation des mâchefers en Occitanie en 2020
-
Service WFS - Ce jeu de données correspond aux installations classées pour l'environnement (ICPE) en activité, ayant une activité de méthanisation. La rubrique ICPE pour ce jeu de données est la 2781 : "Méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale". Le contenu de cette rubrique est décrit ici : https://aida.ineris.fr/reglementation/2781-installation-methanisation-dechets-non-dangereux-matiere-vegetale-brute-a Le régime général de l'installation correspond au régime de classement pour l'ensemble des activités de l'installation.
 Picto-Occitanie
Picto-Occitanie